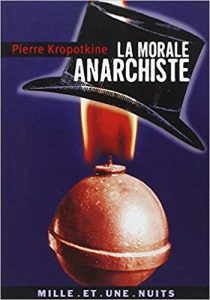« Dans notre imaginaire, que la démocratie athénienne était belle ! Et pourtant elle mourut. »
C’est par ces mots, suivis d’un extrait d’un discours de Périclès rapporté par Thucydide, que Philippe Kourilsky choisit d’ouvrir son essai sur la démocratie et la science. Il y a deux façons de les interpréter. La première serait d’y voir une nostalgie de la conception antique de la démocratie, interprétation qui sera écartée par la suite. La seconde sous-entendrait que nous idéaliserions trop la démocratie athénienne alors qu’elle ne portait pas en elle les qualités nécessaires à sa propre survie. Pour qui sait que la démocratie athénienne a laissé place à un régime oligarchique suite à sa défaite face à la Macédoine, menée par Alexandre le Grand, cette introduction peut laisser perplexe car ce sont bien des raisons extérieures et non intérieures qui mirent un terme à la démocratie.
Mais soit, passons sur cette maladresse et penchons nous sur l’intention, explicite cette fois ci, de l’auteur : « La science, même si elle implique de l’intuition, est, par méthode, ancrée dans le rationnel. La démocratie exige, dans la conception et la réalisation de l’action, forcément collective, une qualité de rapports humains dont la dimension affective est un moteur puissant. Ma thèse est que l’injonction de raison, à l’aide de la méthode scientifique, peut servir les démocraties en toutes circonstances, mais particulièrement dans les temps difficiles qu’elles traversent. »
Si Kourilsky est un scientifique, comme il ne manquera pas de le souligner avec une insistance déconcertante, il reste cependant très vague quant à ce qu’est la science et en quoi consiste la méthode scientifique. Nous savons cependant qu’elle est « ancrée dans le rationnel », ce qui nous avance beaucoup. Il sera un peu plus éclairant sur la démocratie dont il ne s’abaissera cependant pas à rappeler immédiatement l’étymologie. La démocratie est « forcément collective », ce qui se comprend tout à fait puisqu’elle n’est ni plus ni moins que le gouvernement du peuple. Et parce que nous trouvons cette définition presque immédiatement après une référence à Périclès, il paraît normal de songer à la démocratie entant que ce qu’elle fût autrefois, notamment sous l’ère du célèbre stratège athénien, soit l’exercice direct de leur souveraineté politique par les citoyens. Nous sommes donc bien loin de ce qu’on appelle aujourd’hui la « démocratie représentative ». Mais du fait que la démocratie, telle qu’évoquée précédemment, n’existe plus dans nos sociétés contemporaines qui ont toutes adopté des régimes représentatifs, on voit difficilement en quoi elle traverserait des « temps difficiles », à moins que la définition de la démocratie n’ait changé entre temps. Et c’est là que le bât blesse. Il règne une grande confusion conceptuelle entre ce que signifiait la démocratie il y a 2500, voire 300 ans, et les régimes que l’on qualifie de « démocratiques » aujourd’hui. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus tard, bien qu’il soit déjà difficile d’être enthousiaste à l’idée de construire une réflexion saine sur des fondations aussi fragiles.
Pensée complexe, hasard et déterminisme
Kourilsky, dont on ne se privera pas de rappeler qu’il est biologiste, entend traiter de la démocratie sous l’angle de la pensée complexe. Cette dernière a pour objet l’étude des systèmes complexes de manière transdisciplinaire. La cybernétique, qui est l’étude des mécanismes d’information des systèmes complexes, est un de ses piliers. Le lecteur averti aura tout de suite en tête l’approche laboritienne de la question sociale puisqu’Henri Laborit n’est pas moins que le père de la pensée complexe à laquelle il a initié Edgar Morin. Il est donc étonnant de ne trouver aucune mention à Laborit de la part de Kourilsky, éclipsé par les références à Morin. Soit.
Nous retrouvons par conséquent la même analogie faite 45 ans plus tôt dans La Nouvelle Grille entre systèmes vivants et systèmes sociaux.
« Les démocraties sont, à leur manière, des systèmes vivants. Elles naissent et vivent. Elles peuvent aussi mourir. Je leur applique la même sentence. Il ne suffit pas qu’elles vivent : il faut qu’elles survivent. Je sais bien que comparaison n’est pas raison, et que l’analogie entre un organisme vivant et un système social comme une démocratie a ses limites. Mais elle a aussi ses zones de validité. Les démocraties doivent se protéger contre les hasards de la vie, qui peuvent provenir de leur environnement comme de leur « milieu intérieur ». Loin de tenir leur survie pour acquise et de rester passifs, nous devons, au contraire, être aussi vigilants qu’actifs. Par conséquent, il nous faut identifier et analyser, de façon lucide et critique, les dispositifs qui, dans une démocratie, surveillent et corrigent les inévitables dysfonctionnements et imprévus, internes et externes, que son existence lui réserve. Ce sont ces mécanismes qui la rendent robuste[1], et en assurent la survie. La robustesse d’une démocratie est son assurance sur la vie. »
Si nous ne nous attarderons pas davantage sur la nature de la pensée complexe de Kourilsky, certaines de ses conclusions, en partie empruntées à Edgar Morin, méritent qu’on s’y attarde. Il est ici soutenu que les systèmes complexes seraient soumis au hasard, ce qui nous contraindrait à rompre avec la conception déterministe du monde qui s’est imposée aux esprits éclairés par la compréhension des lois de nature. La thèse a de quoi surprendre puisque Laborit lui-même ne semble pas avoir eu besoin de rompre avec sa conception d’un « déterminisme universel » en élaborant le concept de pensée complexe.
« Les succès de la mécanique classique dans le calcul et la prévision du mouvement des astres ont imprimé une vision déterministe du monde, avant que l’invention des probabilités ne vienne ouvrir le champ au hasard. Celui-ci a débouché sur l’incertitude, inhérente à la mécanique quantique, et consacrée par les progrès de la logique formelle, avec les théorèmes d’incomplétude. »
Il est très gênant de voir, dans un ouvrage écrit de la main d’un scientifique qui plus est, les statistiques, les théorèmes d’incomplétude de Gödel et la physique quantique servir d’alibi à l’existence du hasard et de l’indéterminisme. Nous aurions aimé avoir plus de précisions sur ce qui, dans la physique quantique, permet à Kourilsky d’avancer aussi sûrement qu’elle permet de réintroduire le hasard dans notre conception du monde tant ce point fait peu consensus au sein du monde scientifique et philosophique. Si on entend parfois parler « d’indéterminisme » quantique à cause des difficultés que nous avons de comprendre la prédictibilité seulement statistique du déplacement des particules à l’échelle subatomique, il reste très cavalier de s’avancer à affirmer que la mécanique quantique n’est pas régie pas des relations déterministes. Il faudrait pour cela que notre puissance technologique nous permette d’appréhender l’échelle quantique avec moins de difficulté. Et quand bien même nous serions en mesure d’affirmer que le monde quantique échappe au déterminisme, il faut bien garder en tête que la physique classique n’en est pas moins strictement déterministe. Le hasard quantique, s’il existe, ne doit être conçu que dans son domaine de compétence, soit le quantique. Il est aussi possible que Kourilsky ne conçoive le déterminisme que de manière étriquée, c’est-à-dire de manière linéaire et impliquant nécessairement la prédictibilité.
Quant aux théorèmes d’incomplétude de Gödel, ils établissent uniquement que certaines vérités mathématiques sont indémontrables. Ils ne font aucunement intervenir la notion de hasard, pas plus que les statistiques. Même chez Morin, les théorèmes d’incomplétude et la physique quantique ne servent qu’à illustrer les limites de la pensée logique et du positivisme. Ils ne peuvent prétendre à invalider le déterminisme global établi par les sciences de la nature.
Comme il est assez difficile de concevoir ce que peut être le hasard en sciences naturelles et qu’il n’est pas clairement défini ici, nous allons tenter d’en interpréter le sens à travers ce que dit Kourilsky des systèmes vivants :
« Ces mécanismes [ndlr : systèmes immunitaires, etc.] assurent notre survie dans les deux sens du terme. Ils nous empêchent de mourir, et ils ont aussi un caractère « assurentiel » : ils nous fournissent une assurance-vie qui n’a pas de prix, ils nous protègent contre les « hasard de la vie », contre toutes sortes d’évènements imprévus ».
« la robustesse est un instrument de la gestion du hasard. »
« Il faut encore faire place au hasard. Le hasard (heureux ou non) est omniprésent. Il est un moteur de l’évolution des espèces. Pour une part, parfois minuscule mais jamais nulle, il règle et il dérègle le climat, les écosystèmes, les sociétés humaines. Malheureusement, il est source de catastrophes naturelles, d’accidents, de maladies et de pannes. La robustesse est le stabilisateur d’un système complexe face aux hasards de son existence. Elle limite les aléas et les dégâts. Les attitudes trop déterministes ne font pas bon ménage avec la pensée complexe. »
Le hasard est donc compris chez Kourilsky comme ce qui est imprévisible, ce qu’on ne saurait prédire, mais ne se s’oppose pas au déterminisme. Il n’est synonyme que d’ignorance. C’est d’ailleurs une caractéristique des systèmes complexes, ou chaotiques, que d’être difficilement prédictibles car leur complexité les rend extrêmement sensibles aux conditions initiales. Cette sensibilité est parfaitement illustrée par la métaphore de l’effet papillon.[2] Un système chaotique n’en devient pas forcément indéterministe.
On se demandera aussi s’il peut exister des degrés dans le déterminisme lorsque que Kourislky affirme que la pensée complexe n’est pas compatible avec les « attitudes trop déterministes ». Peut-on être un peu déterministe ? Peut-on penser que l’état de la matière à un instant t dépend de son état à un instant t-1, mais pas trop ? Si nous voulons être de bonne foi, nous l’interpréterons comme l’idée que la pensée complexe n’est pas compatible avec un déterminisme réductionniste, simpliste et linéaire. Mais cela tombe sous le sens. Le déterminisme des systèmes complexes, faits d’une multitude d’interactions et de rétroactions, est nécessairement complexe lui-même et fait intervenir des réponses plus nuancées, plus probabilistes que celles de problèmes physiques simples. Mais ces réponses statistiques et probabilistes ne sont le symptôme que de notre ignorance. Si nous lançons une pièce de monnaie en l’air et que nous souhaitons savoir, avec le seul secours de nos sens, sur quelle face elle retombera, nous serons obligés de répondre avec des probabilités. Il y a autant de chances qu’elle atterrisse sur pile que sur face. Mais si nous utilisons un matériel de pointe qui nous permette de calculer sa vitesse, son poids et une multitude de facteurs telles que la résistance de l’air ou la température, nous pourrons délivrer une réponse précise et exacte car nous maîtriserions la (quasi) totalité des facteurs qui régissent le mouvement de la pièce. De manière plus générale, il faut s’imaginer qu’un observateur omniscient et aux capacités de calcul infinies serait en mesure de prévoir très exactement le déplacement de toutes les particules de l’univers. Il n’aurait jamais besoin de recourir aux statistiques et aux probabilités. Mais comme cela ne relève que de l’exercice de pensée, nous devons nous résoudre à pallier à notre finitude avec les statistiques, sans qu’elles ne fassent jamais intervenir aucun concept qui nous contraigne à rompre avec le déterminisme.
La démocratie
Puisque l’objet du livre reste le lien entre science et démocratie, nous allons nous attarder sur cette dernière. Dans un chapitre intitulé « L’idée de démocratie n’est pas réductible à sa dimension électorale », nous pouvons lire :
« La croissance démographique a provoqué partout des changements de gouvernance notables. L’antique république athénienne comptait quarante mille citoyens sous Périclès. Lorsque, dans d’autres lieux et d’autres temps, leur nombre s’est accru, il a fallu inventer des mécanismes de délégation de pouvoir à des représentants plus généralement élus que tirés au sort. »
Ainsi Kourilsky affirme sans sourciller que les régimes représentatifs seraient issus des régimes démocratiques pour des raisons pratiques et démographiques. Cette affirmation gratuite contient deux erreurs. D’abord les régimes représentatifs se sont construits par opposition aux régimes démocratiques, ils n’en sont pas issus. Pour reprendre les mots de Bernard Manin, « les démocraties contemporaines [ndlr : démocratie représentatives] sont issues d’une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie ».[3] Ensuite, la démocratie n’a pas cédé la place à la représentation pour des raisons démographiques. Si Kourilsky termine sa phrase sur une note renvoyant vers De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes de Benjamin Constant, l’argument de ce dernier en faveur des régimes représentatifs (qu’il se garde bien de qualifier de démocratiques) n’est pas démographique : « Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d’hommes par la masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient défendus, et qui néanmoins n’a pas le temps de les défendre toujours lui-même. »
L’abandon du pouvoir politique qui définit la liberté des anciens à des représentants serait, pour Constant, motivé par l’optimisation de la jouissance des biens privés qui deviennent une source de gratification supérieure à l’exercice de la chose politique. Si cette explication est tout aussi discutable que celle de Kourilsky, elle n’en est pas moins différente.
Pour illustrer l’opposition entre régimes représentatifs et démocratiques nous nous appuierons sur deux contemporains de la révolution française. Jean-Jacques Rousseau, démocrate, et l’abbé Seiyès, partisan du gouvernement représentatif.
« La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. »
Du contrat social, Jean-Jacques Rousseau
« La France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi, n’est pas douteux parmi nous. D’abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n’a ni assez d’instruction, ni assez de loisir, pour vouloir s’occuper directement des lois qui doivent gouverner la France ; ils doivent donc se borner à se nommer des représentants. […] Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
Sur l’organisation du pouvoir législatif et la sanction royale, Abbé Seiyès
Il nous faut également ajouter quelque chose sur le nom du chapitre, « L’idée de démocratie n’est pas réductible à sa dimension électorale ». S’il y a bien un aspect de nos démocraties contemporaines qui n’a rien de démocratique, c’est sa dimension électorale. Si le tirage au sort a toujours été préféré à l’élection dans les démocraties antiques, exception faite des stratèges, c’est bien aux régimes monarchiques et aristocratiques que nous devons cet héritage. On élisait des rois, comme Hugues Capet, bien avant l’apparition des démocraties représentatives. Le principe de l’élection est de choisir le meilleur. Elle est d’essence aristocratique. La démocratie représentative n’est que la synthèse du régime représentatif et d’une légitimation pseudo-démocratique, l’élection, qui est en fait un héritage aristocratique.
« Beaucoup imaginent que, si la volonté du peuple était correctement exprimée grâce à un jeu de procédures parfaites, et si elle était transmise à des dirigeants dûment mandatés qui réaliseraient exactement ce que le peuple attend d’eux, l’idéal démocratique serait atteint. Vraiment? Qui, après quelques minutes de réflexion, pourrait croire une telle fable? »
C’est très précisément cela la démocratie ! Que la volonté du peuple face loi et que ceux qui la mettent en place ne soient que ses ouvriers, et non ses chefs. Les institutions de l’Athènes de Périclès, à travers le mandat impératif, les magistratures collégiales et les obligations qu’avaient les magistrats de rendre des comptes devant l’Ecclesia ne traduisent pas autre chose. Il est effarant de lire que l’idéal démocratique serait une fable et on se demande bien combien de minutes de réflexion a bien pu passer Kourilsky à étudier l’histoire démocratique et ce qu’il a pu retenir de Constant qui éclaire tout même assez sur la conception de la liberté politique des anciens.
« Cela supposerait que tout soit parfait : que le peuple soit parfaitement informé, qu’il ne change pas d’avis trop vite, que les dirigeants soient d’une parfaite obédience, qu’ils restituent parfaitement les résultats de leurs actions, qu’ils ne cherchent pas à influencer indûment le peuple, etc. »
Nous nous rendons compte ici que Kourilsky n’a en réalité aucune idée de ce qu’est la démocratie. Il adopte comme postulat, en déclarant que le peuple doit être parfaitement informé, que la démocratie doit aboutir aux meilleures décisions. Non, la démocratie est le gouvernement du peuple et on ne se préoccupe que de savoir si sa volonté fait loi, pas de savoir s’il se trompe sur telle ou telle question. Est-ce que les athéniens ont eu raison d’exécuter leurs stratèges lorsqu’ils ne rapatrièrent pas les corps de leurs concitoyens défunts? Probablement pas. La décision en était-elle moins démocratique? Non. Elle a été prise par l’Ecclesia. Ce n’était peut-être pas une décision éclairée, mais elle était démocratique. Mais justement, l’accès à l’information des masses doit être un but poursuivi par toute société démocratique pour qu’elles puissent justement prendre des décisions qui servent réellement leurs intérêts.[4]
Quant aux dirigeants d’une parfaite obédience, c’est justement parce qu’ils n’existent pas que la démocratie recourt au mandat impératif. Les grecs se méfiaient bien de leurs semblables, c’est pourquoi ils ne leur accordaient pas de pouvoir indépendant de l’autorité de l’Ecclesia. Le magistrat est soumis à la volonté populaire qu’il doit impérativement respecter sous peine de lourdes sanctions, voire de mort pour revenir à l’exemple de nos malheureux stratèges. La démocratie est un système taillé sur mesure pour les êtres imparfaits et trop souvent intéressés que nous sommes. L’argument se retourne par contre parfaitement contre le régime représentatif qui garantit une indépendance du mandaté vis-à-vis du peuple. Aussi nous constatons quotidiennement en quoi il exacerbe les passions humaines et laisse place à la corruption, au mensonge et à la manipulation. Kourilsky adresse ici des critiques qu’il devrait réserver à la démocratie représentative.
Conclusion
Nous arrêterons ici notre lecture, éprouvante, avec la fin du premier chapitre. La confusion qui y règne n’augure rien de bon pour la suite, à laquelle nous ne manquerons toutefois pas jeter un œil. Nous retrouvons chez Kourislky la même confusion issue de la dissonance qu’engendrent deux définitions contradictoire de la démocratie. Il est également regrettable de voir l’héritage intellectuel de Laborit foulé aux pieds avec aussi peu d’humilité, surtout lorsque l’outrage est accompagné de tels commentaires sur le déterminisme.
Un premier chapitre tout à fait dispensable qui nous éloigne de la compréhension du monde plus qu’il nous en rapproche. Nous lui préférerons des œuvres plus anciennes qui, si elles méritent d’être actualisées à la lumières des récentes découvertes scientifiques, n’en demeurent pas moins beaucoup plus éclairantes, à l’image de La Nouvelle Grille.
[1] Kourilsky appelle « robustesse » la capacité d’un organisme vivant à faire face aux aléas extérieurs et aux troubles intérieurs, soit à maintenir son homéostasie.
[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_papillon
[3] Principes du gouvernement représentatif, Bernard Manin
[4] https://refractairejournal.noblogs.org/post/2019/11/30/science-morale/