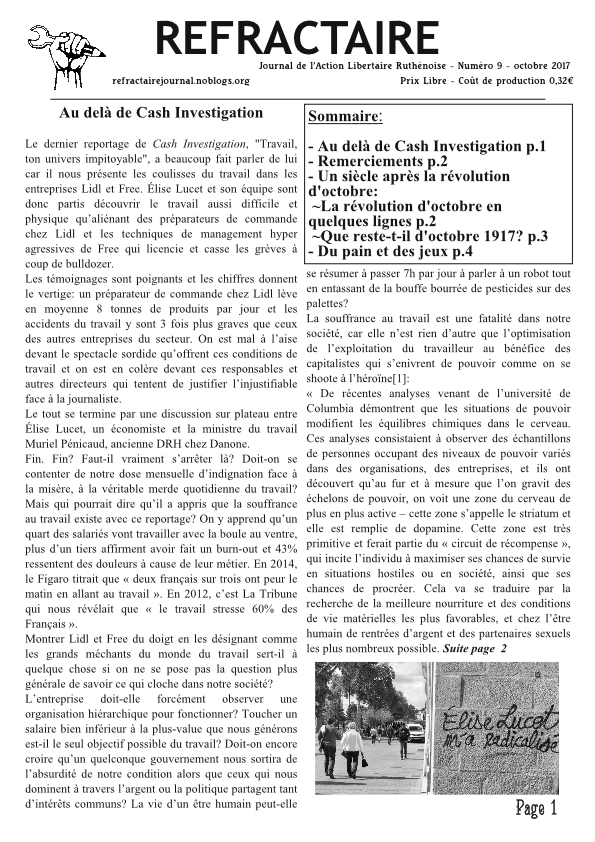Comme l’ont fait Aristote, Marx et Freud avant lui, Henri Laborit tente dans La Nouvelle Grille (1974) de donner une grille de lecture du monde pour mieux appréhender l’Homme et notre société.
Dans son chapitre VI: Information, hiérarchies de valeur et classes sociales. Malaise et crises sociales, Laborit aborde les concepts de classes sociales et de lutte des classes introduits par la philosophie marxiste. Cette dernière repose sur l’idée que le moteur de l’Histoire est la lutte entre deux classes sociales opposées: le prolétariat et la bourgeoisie, la seconde exploitant la première. La bourgeoisie s’approprie, du fait de la propriété des moyens de production, la plus-value[1] issue du surtravail des prolétaires.
En analysant les modes de production contemporains et leur automatisation, Laborit entant mettre à jour la nature de la plus-value et qui est le plus dépossédé de la plus-value qu’il génère. D’abord, l’ouvrier joue-t-il toujours le même rôle dans la production de marchandises?
« C’est grâce à une information de plus en plus abstraite, qu’avec la révolution industrielle l’homme a pu se rendre maître de l’énergie et traiter la matière de façon à fabriquer des quantités considérables d’objets, le capital restant jusqu’à nos jours le moyen le plus efficace de domination des hommes et des groupes humains entre eux.
Aussi longtemps que ces objets ont été réalisés essentiellement par le travail manuel de l’ouvrier, c’est par l’intermédiaire de la plus-value, comme Marx l’a montré, celle de la retenue par le possesseur du capital d’une partie du produit du travail humain non restitué à celui qui l’a fourni, que fut constituée l’accumulation du capital. A mesure que les machines prirent de l’importance dans la production des marchandises, inversement le travail manuel de l’ouvrier prit relativement moins d’importance au sein du processus de production. Le capitaliste utilisa la plus-value pour s’approprier aussi des moyens de production de masse, les machines, en investissant. Il augmentait ainsi son pouvoir puisque, sans machines, l’ouvrier devenait inefficace et que ces machines ne lui appartenant pas il devint possible de l’obliger à accepter tous les désirs du patron. C’est en cela que la disparition de la propriété privée des moyens de production est un élément indispensable bien qu’insuffisant à la disparition de la dominance.
Mais ces machines, capables de fournir une quantité considérable de marchandises dans un minimum de temps, d’augmenter considérablement la productivité des entreprises, étaient filles de l’invention, dans le domaine des sciences fondamentales d’abord, puis de leur application au domaine industriel, celui de la production de biens consommables. Elles étaient donc filles de l’abstraction. Elles étaient « programmées » par l’homme, ce qui veut dire que l’homme, en établissant leur « structure », les rendait dépositaires d’une information. De même que l’apprentissage de l’ouvrier avait pour but de rendre son système nerveux dépositaire d’une information professionnelle qui se trouvait alors à l’origine d’un comportement, d’une action de l’ouvrier de l’action sur l’environnement assurant à ses gestes l’efficacité, la précision, la rapidité d’exécution dans la production des marchandises, la machine devenait dépositaire d’une information aboutissant à la production massive d’objets. Son efficacité était immédiatement beaucoup plus grande que celle de l’homme car non limitée dans sa puissance énergétique, à peine dans sa vitesse d’exécution, moins sujette à erreurs, et si elle exigeait un entretien elle n’émettait pas de revendications : l’ouvrier pouvait refuser de restituer, pour le profit et la dominance de quelques-uns, l’information stockée dans son système nerveux par l’apprentissage, alors que la machine n’attendait que son alimentation énergétique pour obéir. L’ouvrier n’était plus là que pour la « servir », et non pas pour la commander. »
Ensuite, si l’ouvrier n’est plus que le serviteur de la machine qui nécessite bien moins d’information professionnelle de sa part, quels sont ceux qui génèrent la plus-value à travers ces machines?
« Ainsi, le capitaliste dut-il commencer à compter, non avec les machines, mais avec ceux qui fournissaient l’information nécessaire à leur invention, à leur construction et à leur utilisation : avec le technocrate. Parmi ces derniers et du fait même de l’abondance de plus en plus considérable de la production, certains se spécialisèrent dans l’administration du processus de production, d’autres dans l’écoulement des produits. De toute façon, avec l’avènement des machines, l’information devient l’élément important du processus de production aux dépens de la force de travail de l’ouvrier. Notons que cette force de travail avait elle-même un aspect énergétique, thermodynamique, intimement lié dans l’organisme humain avec l’aspect informationnel acquis par l’apprentissage. Avec l’industrialisation, l’aspect énergétique, fut en grande partie pris par la machine. L’aspect informationnel aussi, mais en tirant sa source du système nerveux humain. En résumé, la part humaine la plus importante dans le processus de production est devenue informationnelle. C’est l’homme qui est à la source des informations stockées dans les machines. Or, comme ce sont les machines qui permettent une production de masse et en conséquence des profits massifs, le donneur d’information devient de plus en plus nécessaire à l’expansion de la production.
En retour, bien entendu, ce qui est rétribué en pouvoir économique et hiérarchique, c’est bien principalement la part informationnelle contenue dans le produit du travail humain. Il s’ensuit logiquement que la « plus-value », ce qu’abandonne le « travailleur » à quelque niveau hiérarchique où il se situe, c’est surtout de l’information. Plus son travail est riche en information spécialisée, plus le degré d’abstraction atteint par son apprentissage est élevé, plus la part informative qu’il abandonne au monstre qu’on appelle le patron est grande et plus sa spoliation est grande aussi. En ce sens, plus un travail est « intellectualisé », plus le travailleur est exploité, puisque nous sommes bien forcés d’admettre que l’importance de la plus-value, de nos jours, est fonction du degré d’abstraction de l’information spécialisée qu’est capable de restituer un individu. »
Si au XIXe siècle les masses laborieuses se révoltaient à de nombreuses reprises à travers le monde, menant parfois à des révolutions mais revendiquant toujours une amélioration de leur condition, pourquoi n’en est-il pas de même pour la nouvelle classe spoliée de sa plus-value?
« Puisque nous en sommes maintenant persuadés, la source la plus abondante de plus-value n’est pas le travail manuel, la force de travail, l’activité thermodynamique de l’ouvrier, mais l’utilisation de l’information sous une forme de plus en plus abstraite, parce qu’elle est capable de façonner la matière, de la « transformer » en machines, de l’ « informer », et que ces machines permettront d’accroitre considérablement la production, donc le profit et en conséquence la dominance, on peut se poser la question de savoir pourquoi les technocrates ne sont pas à la tête du mouvement révolutionnaire contre le pouvoir des détenteurs du capital. »
La première raison est à chercher dans la structure de notre société qui n’est plus celle du XIXe siècle. Si l’opposition binaire entre le prolétariat et la bourgeoisie correspondaient à une certaine réalité économique, qu’en est-il à la fin du XXe siècle? Sommes nous toujours en présence de ceux deux mêmes blocs antagonistes?
« La plus immédiate [des raisons], c’est que la domination n’est plus liée au seul pouvoir du capital. Rappelons que la finalité fondamentale d’un organisme vivant est la recherche du plaisir qui s’obtient par la dominance[2]. Aussi longtemps que celle-ci aboutit à deux types d’individus, le maître et l’esclave, l’oppresseur et l’opprimé, le dominante et le dominé, la distinction hiérarchique est simple, l’antagonisme facile. Dès qu’un système hiérarchique complexe apparaît il n’en est plus de même. Ce qui fait la solidité d’un système hiérarchique complexe, c’est qu’on y trouve à chaque niveau de l’échelle des dominants et des dominés. Dans un tel système, tout individu est dominés par d’autres mais domine un plus « petit » que lui-même ; le manœuvre le plus défavorisé, dans notre système social, en rentrant chez lui frappera du poing sur la table, s’écriera : « Femme, apporte-moi la soupe » et, si un enfant est un peu turbulent, il lui donnera une claque. Il aura l’impression d’être le maître chez lui, celui auquel on obéit, celui qu’on respecte et qu’on admire, tout enfant prenant son père comme idéal du moi dans sa tendre enfance. Cette domination familiale lui suffira souvent à combler son désir de se satisfaire. Par contre, dès qu’il sort de chez lui il trouvera des dominants, ceux situés à l’échelon immédiatement supérieur dans la hiérarchie du degré d’abstraction de l’information professionnelle. Et, comme le chimpanzé soumis à l’égard du chimpanzé dominant, tout son système nerveux sera en remue-ménage, en activité sécrétoire désordonnée, car dans nos sociétés modernes il lui est impossible de fuir[3]. Il doit se soumettre. Il ne peut plus combattre sous peine de voir sa subsistance lui échapper. Il en résulte une souffrance biologique journalière, un malaise, un mal-être. »
On peut également illustrer cette position d’individu à la fois dominant et dominé au sein du monde du travail avec la multiplication des échelons intermédiaires: manager, chef d’équipe, chef d’unité, chef de secteur, etc. Les rapports hiérarchiques dans le travail ressemblent de plus en plus à un spectre qu’à une opposition de deux parties distinctes.
Mais l’exercice de la dominance compensatoire ne s’effectue par forcément dans le même contexte que la dominance subie. Ainsi celui qui est dominé au travail peut exercer une forme de dominance dans le cadre de la famille, ou inversement.
Dans tous les cas le résultat reste le même. C’est un malaise qui résulte de cette situation ambiguë, mais il n’a pas le caractère aussi unilatéral de la dominance uniquement subie qui conduit à la crise qui est nécessaire pour déclencher une révolte. Cette crise ne survient que lorsque la société hiérarchisée n’offre pas assez de « tampons », d’échelons intermédiaires, et que la séparation entre dominants et dominés se fait sous forme d’une ségrégation.
« Cependant, cette soumission n’a pas que des inconvénients. Le travail en « miettes » qui institue une dépendance étroite de chaque individu à l’égard des autres, n’est plus ressenti seulement comme une aliénation. Alors que l’homme du paléolithique était un véritable polytechnicien à l’égard de la technique du moment, l’homme moderne est incapable, quelque soit son niveau technique, de subvenir seul à ses besoins fondamentaux. Ce qui l’homme moderne ressent comme une aliénation, c’est de ne pouvoir décider de son propre destin, de ne pouvoir agir sur l’environnement, dans tous les cas par un acte gratifiant pour lui-même. Mais d’un autre côté, cette absence de pouvoir de décision, […] le sécurise. Il sait qu’il a peu de chances de mourir de faim et que certaines responsabilités lui sont épargnées. Son déficit informationnel, source d’angoisse, est considérable et cependant il fait confiance à ceux qui sont prétendus savoir et agir à sa place. Cette confiance le sécurise.
[…] Ce mélange d’assouvi et d’inassouvi est pour nous l’origine du « malaise » social. »
Si la société hiérarchisée complexe rend l’individu de plus en plus dépendant des autres à travers la spécialisation toujours plus poussée des tâches à exercer dans le travail et de la complexité croissante des processus de production pour faire parallèlement croitre la production de marchandises, elle sécurise par là même l’individu. Non seulement ses moyens de subsistances sont assurés s’il joue le jeu et travaille, mais ses responsabilités seront aussi limitées que la tâche qu’il a à accomplir. On peut alors légitimement se demander s’il faudra attendre que la situation économique se détériore au point de retrouver l’incertitude d’assouvir nos besoins fondamentaux pour que les choses changent. Dans des pays comme le Venezuela ou la Grèce il semblerait que ce soit bien l’atteinte aux besoins les plus primaires que sont l’alimentation, le soin et le logement, à travers la dégradation des conditions économiques, qui soient à l’origine des émeutes et des manifestations les plus fédératrices et massives. Sauf que même dans ces cas là les revendications ne dépassent que rarement la volonté de changer les figures qui incarnent l’autorité, ceux que l’ont désigne comme responsables, en espérant que d’autres fassent mieux. Nous en arrivons à une autre raison de l’absence de révolte du technocrate:
« D’autre part, plus le niveau de décision s’éloigne de lui, plus il devient abstrait, plus il a tendance à l’occulter. En réalité, sa gratification, comme sa souffrance d’aliénation, se situent dans son entourage immédiat, dans la partie de sa niche environnementale qu’il peut toucher chaque jour de la main, celle dont il peut découvrir simplement la structure et la causalité. Qu’il en retire gratification ou souffrance, il aura tendance alors à rendre responsable de son état les niveaux d’organisation dont il ne possède qu’une idée abstraite ; il retrouve en quelque sorte, de nos jours, la tendance mythique des premiers hommes à l’égard des dieux. Les dieux modernes ont pour nom Liberté, Égalité, Démocratie, État, Classes sociales, Pouvoir, Justice, Partis, etc., et leurs prêtres efficaces ou maladroits, despotes ou bienveillants, s’appellent gouvernants, PDG, bourgeois, technocrates et bureaucrates, patrons, cadres, permanents, etc.
Déçus par certains intermédiaires et certains dieux, l’homme moderne souhaite parfois améliorer son sort en changeant de religion. Mais il ne remet jamais en question le système hiérarchique, ses causes (nous dirions ses facteurs comportementaux) et n’a pas encore compris qu’en déplaçant simplement les pièces sur l’échiquier, il n’en fera pas pour autant disparaître le quadrillage, c’est-à-dire la structure de base, celle des comportements.
Nous commençons à comprendre ainsi pourquoi le technocrate est assez rarement révolutionnaire et ne cherche pas à faire disparaître non pas le pouvoir établi, mais beaucoup plus précisément la structure hiérarchique.
C’est que cette structure hiérarchique lui permet de se gratifier. »
Mais si le technocrate trouve dans la structure hiérarchique une source de gratification, de quelle nature est le pouvoir qui lui est concédé? Sommes-nous gouvernés par les technocrates?
« L’activité de l’ensemble social étant fondamentalement orientée vers la production de marchandises, cette production étant fonction de l’invention, de la création et de l’emploi des machines, celles-ci étant elles-mêmes fonction du degré d’abstraction de l’information professionnelle, on comprend qu’une place hiérarchique de choix soit réservée dans ce système au technicien. Une place hiérarchique d’autant plus élevée qu’il se montre capable de traiter les informations d’une façon plus abstraite et moins thermodynamique puisque plus l’abstraction sera grande, plus la généralisation de son emploi sera forte et plus son efficacité productrice sera appréciée. Mais il est essentiel de comprendre que le « pouvoir » qu’il conquiert ainsi est strictement limité au processus de production, et nous verrons qu’il n’a aucune raison, en principe, d’être lié à un pouvoir politique puisqu’il n’est pas fondé sur un savoir politique. »
Qu’en est-il alors de la lutte des classes?
« Mais nous avons déjà insisté sur le fait que le traitement de l’information était une particularité de l’espèce humaine et que l’homme du paléolithique en cela s’est distingué tout de suite des espèces animales qui l’avaient précédé en « informant » la matière inanimée par la confection des premiers outils. Cette particularité en elle-même n’est donc pas suffisante pour donner naissance aux hiérarchies. C’est pourquoi nous avons mis en évidence à plusieurs reprises que c’est sur le degré d’abstraction de l’information professionnelle traitée que s’établissent les échelles hiérarchiques. Or il existe tous les niveaux de passage de l’information encore très liée au concret, celle du manœuvre, à celle déjà plus élaborée de l’artisan, à celle enfin de plus en plus abstraite, de l’ingénieur, du technocrate ou du bureaucrate en général. Il en résulte l’existence d’un nombre infini de niveaux hiérarchiques qui, insensiblement, permettent de passer du manœuvre à l’intellectuel.
Dans cette échelle hiérarchique, où finit le prolétaire et où commence le bourgeois? Marx a défini la bourgeoisie par la propriété privée des moyens de production. Les bourgeois vous diront que le capital et les moyens de production sont de moins en moins la propriété de quelques-uns mais celle d’un grand nombre. Dans les pays socialistes contemporains, ils sont même devenus la propriété de l’État, c’est-à-dire en principe à la collectivité. Les systèmes hiérarchiques et l’aliénation qui en résulte ont-ils disparus pour autant? »
Que la propriété privée des moyens de production soit fragmentée à travers l’actionnariat, que les moyens de production soient la propriété de l’État ou qu’ils soient la propriété des salariés d’un entreprise en société libérale comme cela est possible à travers les SCOP, tout cela ne change en rien le problème de l’exploitation qui est le fait de toute structure hiérarchique.
Si la dialectique marxiste qui entend opposer prolétariat et bourgeoisie ne convient plus pour expliquer les rapports sociaux qui ont gagné en complexité, Laborit entend questionner notre rapport au travail, la question du pouvoir des travailleurs, de la dictature du prolétariat et le concept de « classes sociales ».
« Avons-nous le droit de parler de structures de classes? Il est difficile de comprendre, semble-t-il, la phrase si souvent répétée: « Le pouvoir aux travailleurs. » Il faut reconnaître que dans la société actuelle, bien heureux est celui qui peut vivre sans travailler. Bien heureux et bien rare. Le travail peut être plus ou moins bien rémunéré, mais n’existe-t-il alors de travail que mal rémunéré? En d’autres termes, à partir du moment où un travail est bien rémunéré, devient-il un plaisir? Et que dire de celui dont le plaisir est de travailler, quelle que soit la rémunération? Les cas sont rares mais ils existent. J’en sais quelque chose. En définitive, ne serait-il pas plus exact de revendiquer le pouvoir pour ceux qui ne l’ont pas? Mais alors, ceux qui le possèdent doivent-ils en conséquence le perdre? Qui ne voit que le problème est mal posé? Donner le pouvoir à ceux qui ne l’ont pas, n’exige pas de l’enlever à ceux qui l’ont. Généraliser le pouvoir est l’objectif souhaitable car dès lors il n’y aura plus de pouvoir. L’erreur précédente vient sans doute de la conception trop étroite qui est généralement propagée de « classes sociales », de l’opposition classique entre capital et travail.
Dans une organisation quelle qu’elle soit, les individus sont groupés en réalité par une analogie de fonction. Or, on les associe généralement sur une analogie hiérarchique, le patronat, les cadres, les ouvriers, hiérarchie dont le pouvoir est régressif en ce qui concerne les décisions à prendre pour la bonne marche de l’entreprise. En réalité, à côté de cette hiérarchie de valeur qui satisfait l’instinct de puissance, existe fondamentalement, nous l’avons dit, une hiérarchie de fonction que nous avons préféré dénommer « niveau d’organisation » fonctionnels, pour la débarrasser de tout jugement de valeur.
A tel point que si nous avons parlé jusqu’ici de hiérarchies de valeur et de fonction, c’était pour faciliter la compréhension, car en réalité toute hiérarchie est de valeur. L’organisation d’un corps individuel ou social nous montre au contraire des niveaux dans cette organisation. Chaque niveau supérieur englobant le niveau de complexité qui le précède, ne le commande pas: il l’informe grâce à cette « information circulante » dont nous avons parlé[4] et que nous avons distinguée de « l’information structure ».
Dans un tel organisme individuel, où sont les « classes » d’éléments ? Nous savons qu’il existe des fonctions différentes, toutes informées de la finalité de l’ensemble dont dépend leur activité métabolique commandant leur travail « professionnel ». Il existe donc des classes fonctionnelles multiples, chacune concourant à l’activité d’un grand système (nerveux, endocrinien, cardio-vasculaire, respiratoire, locomoteur, digestif, etc.), chacun de ces systèmes concourant à l’activité de l’ensemble organique au sein de l’environnement. Ces classes fonctionnelles n’ont donc rien à voir avec les classes hiérarchiques de la « lutte des classes ». Mais comme d’autre part nous avons vu que, en introduisant la notion d’information en sociologie humaine, les échelles hiérarchiques sont à ce point progressives qu’il est impossible de savoir à quel moment on quitte le prolétariat pour entrer dans la bourgeoisie, impossible de savoir sur quels critères on peut classer un individu dans une classe ou dans une autre, sinon sur un état d’esprit d’appartenance à un parti, on peut se demander si la notion de classe telle qu’elle était comprise et vécue au début du siècle a encore une réalité autre qu’affective.
Par contre, la notion de hiérarchie telle que nous l’avons définie répond à notre avis à une réalité. Elle répond aussi à une caractéristique fonctionnelle du cerveau des mammifères en général: la recherche de la dominance. Elle répond enfin dans l’espèce humaine à la notion d’information et de son degré d’abstraction introduite dans le travail humain.
En conséquence, quand nous parlerons de classes sociales ce sera de classes fonctionnelles, c’est-à-dire de l’ensemble des individus qui dans un organisme social remplissent la même fonction ou une fonction analogue. Seule la conscience de classe et donc l’indispensabilité de cette classe, mais aussi de l’indispensabilité des autres classes fonctionnelles, permet d’atteindre à cette « dignité de la personne humaine » dont on remplit abondamment les discours électoraux, parce que chacun met dans ce mot ce que bon lui semble. On n’est pas plus « digne » quand on est riche que lorsqu’on est pauvre, lorsqu’on tient une une place élevée dans les hiérarchies que lorsqu’on y tient une place plus modeste. Par contre, quand on est riche ou que l’ont détient une place élevée dans les hiérarchies on croit posséder plus de « pouvoir ». On assure plus facilement son plaisir par la dominance. Autant dire que les dominants chercheront toujours à conserver le pouvoir en laissant aux dominés « la dignité » dont ils n’ont rien à faire. Et ce que les dominés chercheront à obtenir, ce n’est pas une dignité dont ils ne voient pas à juste titre à quoi elle peut leur servir, mais bien le pouvoir. Or, aussi longtemps que celui-ci sera lié à l’information spécialisée permettant de s’élever dans les hiérarchies de salaire et de valeur, les sociétés humaines ne pourront sortir du stade thermodynamique de la productivité, puisque de près ou de loin ces hiérarchies ne s’établissent que sur la quantification de la participation informative spécialisée de l’individu à la production de marchandises.
Ainsi, il nous semble que nombreux sont ceux qui se sont laissé prendre à certains automatismes stéréotypés de la pensée, liés aux expressions de « lutte des classes », « société sans classes », à la définition de la bourgeoisie comme classe détenant la propriété privée des moyens de production, et du prolétariat caractérisé par sa seule « force de travail ». Qui ne voit qu’il ne suffit pas de supprimer la propriété privée des moyens de production pour parvenir à une société sans classes et faire disparaître la lutte des classes? Ce qui veut dire que les hiérarchies de valeur ne sont pas liées à la seule possession du capital et des moyens de production. Le pouvoir aujourd’hui est fonction de l’information spécialisée et c’est elle surtout qui permet l’établissement des dominances. Aussi longtemps que les hiérarchies de valeurs fondées sur l’information spécialisée ne sont pas supprimées, il existera des dominants et des dominés. Par contre, si une hiérarchie de fonction s’installe, les classes sociales deviendront aussi nombreuses que les fonctions assurées et un même individu pourra fort bien appartenir à plusieurs classes sociales à la fois, dans plusieurs institutions différentes, suivant ses différentes activités.[…]
Aussi longtemps que les hiérarchies de valeur subsisteront et qu’elles s’établiront sur la propriété par l’intermédiaire de la possession de l’information spécialisée acquise par l’apprentissage manuel ou conceptuel, les dominés chercheront à conquérir un faux pouvoir qui est celui de consommer. Or, la consommation n’a pas de fin, et jamais une égalité réelle des chances et du pouvoir ne pourra s’établir sur la consommation. Le pouvoir réel qu’exige le dominé, c’est moins celui de consommer que celui de participer à la décision. Or, pour cela c’est une information spécialisée qu’il doit acquérir. »
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus-value_(marxisme)#D.C3.A9finition_de_la_plus-value
[2] « Laborit parle de plaisir dans son acception biologique (le circuit de la récompense est un circuit comprenant des voies nerveuses et des hormonales) et pas philosophique. On ne peut y échapper quoi qu’on fasse car ces voies sont « imprimées » très tôt, elles sont toutes liées aux « 3B » (« boire, manger et copuler ») et nous recherchons inconsciemment dans chacune de nos actions à les satisfaire, même quand le langage « habille » de nombreuses couches cet inconscient par des justifications sociétales.
La dominance est simplement le résultat de la compétition pour satisfaire ces voies : elle est inévitable quand par exemple on postule à un travail, on veut séduire pour former un couple, etc. ce qui parait assez évident, mais aussi par ce phénomène de manière bien plus feutrée et sourde pour chaque comportement que nous avons dans la vie. Dominer c’est pouvoir accéder à ce qu’on veut et donc « renforcer » notre circuit de la récompense. » http://www.nouvellegrille.info/surlagrille.html
[3] Dans son analyse des comportements humains Laborit distingue deux façon d’éviter la punition: la lutte et la fuite. Si aucune des deux n’est possible on adopte alors un comportement d’inhibition qui débouche sur l’angoisse.
[4] Voir Chapitre premier: Thermodynamique et information